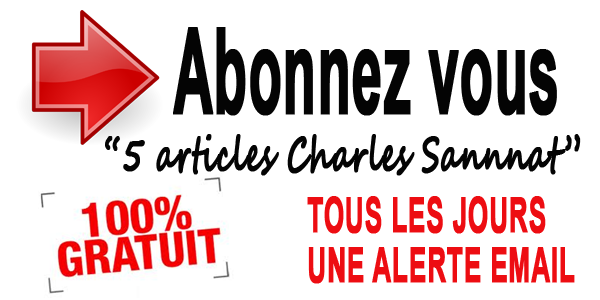Après des années de dépression et de crises en série, les économies de la zone euro assistent soudainement au retour de la croissance. Sans que les électeurs, les politiciens et les marchés sachent vraiment d’où elle vient.
Prenons par exemple la France, où Marine Le Pen reste en haut des sondages à un mois de l’élection présidentielle. La montée en puissance d’une candidate hors système promettant de renverser l’establishment politique et économique aurait semblé logique il y a un an, lorsque la crise grecque semblait critique, que la déflation ne quittait pas d’une semelle la zone euro et que le PIB français baissait.
Mais l’économie française est repartie et pourrait, tout comme celle de l’Allemagne, croître plus vite que même celle d’une Grande-Bretagne qui renaît de ses cendres. Cela n’a pas érodé les chiffres de Le Pen, ou dopé ceux du successeur socialiste de François Hollande, qui ne se trouve même pas dans le top 4. Faisant fi de l’agitation politique, l’économie de la zone euro affiche tout à coup une performance solide.
Son PIB a connu une croissance très respectable de 1,7 % l’année dernière, tandis que la BCE prévoit 1,8 % de croissance pour cette année. Les prévisions du secteur privé font de la France et l’Allemagne les fers de lance de cette croissance inédite depuis 6 ans en zone euro.
L’inflation, que la BCE veut maintenir juste en dessous de 2 %, est également en hausse, s’étant élevée à 2 % février et à 1,5 % en mars. On assiste toujours à des variations pays par pays, mais l’écart entre le taux le plus bas et le plus élevé s’est considérablement réduit durant ces dernières années.
L’économie grecque devrait afficher un taux de croissance de 2,8 % cette année, d’après les prévisions du FMI, tandis que celle de l’Espagne devrait croître de 2,2 %, soit bien plus que la prévision de croissance du FMI pour la Grande-Bretagne de 1,1 %. On ne s’y attendait vraiment pas.
« Si, il y a un an, vous aviez dit qu’il y aurait un Brexit, que Donald Trump serait élu, que Renzi allait perdre le référendum et que malgré tout vous auriez une croissance ininterrompue proche de 0,5 % au premier trimestre de 2017, les gens auraient été ravis », a déclaré Marchel Alexandrovich, économiste senior pour l’Europe chez Jefferies.
Mario Draghi, président de la BCE, pense que plusieurs facteurs positifs expliquent ce renversement.
Dans un tel contexte, Draghi pense qu’il n’y a que lui qui a pu doper la croissance.
« Il ne reste que deux facteurs exogènes susceptibles d’expliquer de façon réaliste la résilience de la reprise : l’effondrement des cours du brut en 2014-2015 et nos politiques monétaires », a-t-il déclaré.
« La croissance dépend beaucoup de ces deux forces. Cela dit, nous pensons que la moitié du supplément de croissance obtenue durant la reprise actuelle est imputable à nos politiques, avec aussi une contribution matérielle des prix du pétrole. »
La BCE a mis du temps pour se mettre à la création monétaire et aux achats d’obligations, en comparaison avec la Federal Reserve ou la Banque d’Angleterre. Mais depuis qu’elle s’y est mis, le coût de l’argent dans la périphérie de la zone euro a baissé.
L’un des taux clés de la BCE, le taux de dépôt, est en territoire négatif à -0,4 %, ce qui signifie que les banques qui parquent de l’argent à la BCE doivent payer pour le faire, ce qui devrait les encourager à prêter.
L’injection de liquidités dans les banques a encore plus contribué, selon les économistes, à doper le crédit.
Cependant, les déclarations de Draghi ne dépeignent pas une vue d’ensemble particulièrement positive des développements en zone euro ; selon les économistes, tous les problèmes ne sont pas abordés.
« Il est plutôt déprimant d’affirmer que sans l’effondrement du pétrole et les politiques fort accommodantes de la BCE, dont elle ne voulait pas au début, il n’y aurait pas de reprise », a déclaré de Jennifer MacLeod, économiste en chef pour l’Europe chez Capital Economics.
« Je pense que c’est probablement un peu négatif, la croissance mondiale de la demande a été relativement forte. »
Mais elle s’accorde à dire que « ce n’est pas le bon moment pour normaliser les taux » vu que la reprise n’est pas durable sans des taux planchers, qui ont présenté l’avantage de faire baisser la valeur de l’euro et donc de favoriser les exportations.
« Cela continuera d’être très important pour les économies de la périphérie », a-t-elle déclaré.
Le regain de forme de l’économie mondiale a également contribué, ce qui ne devrait pas être minimisé. Il y a un an, les marchés étaient terrifiés à l’idée d’un « atterrissage brutal » de l’économie chinoise, susceptible d’entraver la croissance mondiale, mais ce scénario ne s’est pas matérialisé.
De même, l’élection de Trump, jusqu’à présent, n’a pas impacté la croissance mondiale, poussant les marchés actions américains et mondiaux à la hausse et renforçant le dollar, ce qui a aidé la zone euro en rendant les produits et services européens plus compétitifs sur la scène mondiale.
Ce retour de la croissance a eu pour effet de faire baisser le chômage, qui est à un plus bas de 8 ans à 9,5 %.
De tels développements peuvent pérenniser la croissance, alors que de plus en plus de ménages voient leurs revenus augmenter, et donc leur pouvoir d’achat, pour générer à leur tour plus de croissance et d’emplois.
Jusqu’à présent, l’augmentation des salaires reste limitée. Il y a encore beaucoup de travailleurs disponibles, ce qui signifie peu de pression pour une hausse des salaires, mais cela pourrait changer si des indicateurs en faveur d’une reprise encore plus durable devaient apparaître. (…)
Mais ce scénario positif n’est pas partagé par Draghi. Il a insisté sur la poursuite de son QE, jusqu’au moins la fin de cette année. Les taux resteront très bas, et bien au-delà de cette échéance, de peur de casser la reprise.
Alors que la croissance semblait faire son retour en 2011, la BCE avait relevé ses taux pour connaître ensuite la crise de la dette, qui avait démoli la croissance et débouché sur des années de troubles politiques et économiques.
La Grèce fut le symbole de cette période. Aujourd’hui, Athènes est à nouveau au centre de discussions internationales visant à déterminer combien elle peut payer à ses créditeurs, ainsi qu’à ses retraités, et quelles réformes sont les plus nécessaires pour améliorer ses perspectives à long terme. (…)
Si ce regain de croissance est le bienvenu, les problèmes structurels de la zone euro, qui mènent à des déséquilibres entre les pays riches et les pays pauvres, ainsi que le souci quasi permanent de la Grèce, n’ont pas été résolus.
« Il s’agit du premier pas d’un long chemin », a déclaré Peter Dixon, économiste en chef pour le Royaume-Uni de Commerzbank.
« La zone euro doit décider de ce qu’elle veut être, de ce qu’il convient de faire, notamment pour régler le problème grec. Tant que cela ne sera pas fait, le chemin sera très long. »
Les options possibles sont l’effacement d’une partie de la dette grecque, pousser la Grèce hors de l’euro, poursuivre la politique actuelle de l’autruche ou mettre en place une union fiscale au sein de laquelle les pays riches paient en partie pour les pays pauvres.
L’expérience grecque de tentative de réformes économiques n’est pas unique, d’autres États membres ont fait la même chose, avec un taux de réussite variable.
L’Espagne a enregistré des progrès dans la libéralisation de son marché du travail, même si le pays reste fortement divisé entre ceux qui ont un CDI blindé et ceux qui ne trouvent que du travail temporaire.
Le réformiste italien Matteo Renzi n’a pas réalisé les progrès souhaités, ayant perdu le référendum qu’il avait organisé pour effectuer les changements constitutionnels qui lui auraient permis de faire davantage de réformes économiques, et l’obligeant ainsi à démissionner.
Cette croissance retrouvée présente également le risque de voir la pression en faveur de réformes ambitieuses pesant sur les épaules des gouvernements baisser, ce qui serait négatif pour les perspectives de croissance à long terme. Et dans un système de cycles politiques relativement courts, engager des réformes qui prennent des années pour porter leurs fruits peut être difficile.
« Rappelez-vous l’Allemagne, qui était le malade de l’Europe au début des années 2000. Le pays s’est ensuite réformé, l’Allemagne est restée à la traîne pendant quelques années, mais après environ une décennie de maturation ces réformes ont commencé à porter leurs fruits. Dans un même ordre d’idées, rien de ce qui se passe aujourd’hui ne paiera avant longtemps », a déclaré Marchel Alexandrovich.
« Il est trop optimiste de croire que tout changement opéré aujourd’hui aura un impact significatif sur la croissance dans les années à venir. »
Source : article de Tim Wallace du Telegraph (9 avril 2017)