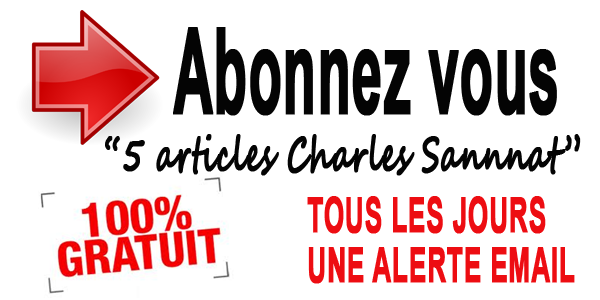On brûle, des voitures et des milliards… Cet article est de Jean-Baptiste Noé de l’Institut des Liberté et acolyte de Charles Gave.
Il revient sur le coût faramineux de notre politique de la « ville », c’est-à-dire de notre politique des banlieues, à savoir pour être encore plus précis encore de notre politique d’intégration de nos populations « populaires »… Vous avez vu comme on peut tourner autour du pot grâce à la sémantique et au politiquement correct pendant des phrases entières ?
Nos « quartiers populaires » consomment donc chaque année des milliards d’euros qui nous coûtent infiniment plus cher, et dans des proportions que vous ne soupçonnez même pas, que les voitures qui sont brûlées chaque année dans notre pays !
Le problème ce n’est évidemment pas les tours ni la taille ou encore moins la hauteur de nos immeubles.
Voici une image des tours de Hong Kong et des appartements « cages ». Il n’y a là-bas aucune délinquance spécifique. Il faut dire que quand on vole, cela se passe mal. Quand on agresse, cela se passe encore plus mal.
Nous n’avons donc aucun problème de logement. Nous avons un terrible problème d’éducation des populations que nous mettons dans ces logements.
Accessoirement, nous avons également un immense problème de « peines » et de « punitions », et donc d’impunité.
Réglez le problème éducation/délinquance des banlieues et vous réglerez le problème des banlieues. La hauteur de l’immeuble est une vaste fumisterie pour cacher la réalité du problème qui gangrène nos banlieues.
La seule politique égalitariste et juste à mener est une politique de répression massive et d’éducation tout aussi massive. Tout le reste n’est que billevesées et calembredaines pour bobos de Terra Nova ou psychopathes de France Stratégies.
Charles SANNAT
En banlieue, on brûle des milliards
Une bonne politique ne se mesure pas aux résultats obtenus, mais aux milliards d’euros dépensés. À ce titre, la politique de la ville est un grand succès. C’est un impératif pour chaque gouvernement : il faut sauver les banlieues, par de la rénovation urbaine, par de la mixité sociale, et par plus d’égalité des chances le tout en conformité avec les valeurs de la République. Revoilà donc Jean-Louis Borloo qui, après une politique de la ville menée tambour battant en 2003, propose un nouveau plan pour sauver les banlieues en injectant 50 milliards d’euros. On l’avait vu partir en Afrique pour électrifier le continent grâce à sa fondation Énergie pour l’Afrique. On le retrouve sur un terrain qu’il connaît bien : les banlieues et la dépense de l’argent public.
La politique de la ville est un cas d’école du capitalisme de connivence menée par la France depuis une quarantaine d’années. De l’argent prélevé par l’impôt sur les territoires et les personnes qui créent de la richesse, pour le redistribuer sur des zones en déshérence afin d’acheter la paix sociale et les voix nécessaires aux réélections. Personne ne semble s’interroger par ailleurs sur les entreprises qui gagnent les contrats d’aménagement et sur leurs liens avec les politiques locaux. N’y a-t-il pas des risques de collusions et de conflits d’intérêts ? Constructions et déconstructions, zones franches, aménagements multiples, création d’écoles, de bibliothèques, de zones de jeux, d’équipements sportifs ; pour toujours plus de violence et de zones dangereuses. La politique urbaine est l’un des échecs les plus manifestes de la politique sociale.
Chronologie de l’intervention de l’État
La liste des lois, plans et actions banlieues donne le tournis. Donnons les principales mesures.
1977 : Opération Habitat et vie sociale sous la direction de Jacques Barrot. Objectif : réhabiliter les HLM.
1981 : Affrontements à Vénissieux dans le quartier des Minguettes. Début du dispositif « Opérations anti été chaud » qui devient ensuite « Ville-Vie-Vacances ». Création des Zones d’éducation prioritaires (ZEP) par l’Éducation nationale.
1981-1983 : Trois rapports sur les villes et les banlieues. Sur l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, sur la délinquance (prévention et solidarité), sur la rénovation urbaine. Trois rapports qui concluent à la nécessité de davantage de dépenses pour les quartiers sensibles.
1983 : Roland Castro lance la mission « Banlieues 89 ». Objectif : réhabilitation des quartiers sensibles.
1988 : Création de la Délégation interministérielle à la ville. L’État centralise la politique de la ville.
1990 : Émeutes à Vaulx-en-Velin. François Mitterrand annonce la création d’un ministère de la ville.
1991 : Michel Rocard lance des grands projets urbains. Mise en place de la loi d’orientation pour la ville (LOV).
1992 : Bernard Tapie devient ministre de la ville. Il propose un plan banlieue et démissionne trois jours après l’annonce de ce plan.
1994 : Création des contrats de ville.
1996 : Création des Zones urbaines sensibles (ZUS) et d’un pacte de relance pour la ville.
2000 : Loi de solidarité et de renouvellement urbain (SRU) qui impose notamment des quotas de logements sociaux (20 %).
2003 : Loi Borloo, Programme national de rénovation urbaine.
2005 : Loi de programmation pour la cohésion sociale.
2006 : Loi pour l’égalité des chances. Automne 2006 : émeutes urbaines.
2008 : Plan banlieue.
2014 : Loi Alur (Accès à un logement urbain rénové) menée par Cécile Duflot qui relève les quotas à 25 % de logements sociaux.
2018 : En attente de la loi d’Emmanuel Macron sur les banlieues.
Une série de mauvaises mesures
Cette synthèse où ne sont indiquées que les principales mesures est déjà indigeste. À relire après coup, elle montre que l’erreur est au fondement même de la politique de la ville : croire que l’intervention de l’État allait pouvoir bien organiser la vie de ces quartiers. Le mal des banlieues remonte à l’origine même, quand l’État a décidé de reconstruire le pays dans les années 1950 et de décider où les Français devraient habiter. Certes il y avait urgence, car après la Seconde Guerre mondiale de nombreux logements étaient détruits et beaucoup de Français vivaient dans des gourbis. Sans compter les bidonvilles qui s’entassaient à Nanterre et dans les villes de la périphérie parisienne. Les grands ensembles répondaient à une nécessité : loger des populations qui étaient à la rue ou qui vivaient dans des cabanes ou des logements insalubres. Les nouveaux logements étaient à cet égard une réussite : propres, neufs, spacieux, éclairés, avec tout le confort moderne, l’eau, l’électricité, la douche et les toilettes dans les logements et non plus dans la cour ou dans le couloir. Ce fut un véritable saut quantitatif qui a été apporté à la population. Mais cette reconstruction s’est combinée à la loi de 1948 qui a gelé les loyers parisiens. Résultat : les propriétaires n’ont plus gagné assez pour faire les travaux de rénovation de leurs appartements. D’où une dégradation du parc urbain et un refus de certains de louer. Ce qui contribua à la grande crise de l’hiver 52. Si beaucoup de Français étaient à la rue cette année-là, c’était d’une part la faute de la guerre et aux destructions, mais aussi à de mauvaises politiques qui ont empêché la rénovation et la reconstruction du parc urbain. La vague de froid extraordinaire a aggravé le problème.
L’effort de reconstruction a été le prétexte à une communisation du pays, d’où les vagues de nationalisation des années 1946-1947. Au lieu de se contenter de grandes directives et d’aides ponctuelles quand cela était nécessaire, l’État a voulu diriger et piloter entièrement la politique urbaine. Nous en payons encore aujourd’hui les conséquences. Sans compter que la population a changé. La dégradation des quartiers n’est pas due seulement à un manque d’entretien, mais aussi au fait que les habitants dégradent et détruisent les lieux qu’on leur propose.
Les effets pervers de la solidarité
C’est toujours au nom de la solidarité que l’on fait les plus mauvaises politiques. Avec l’idée qu’il faut que les villes riches, c’est-à-dire les villes bien gérées, payent pour les villes pauvres, c’est-à-dire les villes mal gérées où la gabegie est une règle. Pour cela il y a l’impôt, pour les particuliers, et la péréquation, pour les collectivités locales. Au nom de la solidarité, les villes qui ont des excédents budgétaires doivent verser une somme à celles qui sont déficitaires. Depuis la révision constitutionnelle de 2003, la péréquation est un objectif de valeur constitutionnelle. L’article 72-2 de la Constitution dispose que « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ». Voici comment la définit l’État français :
« Littéralement, la péréquation consiste à égaliser les situations. Elle doit atténuer les disparités de ressources entre collectivités territoriales au regard des charges auxquelles elles doivent faire face. Ressources et charges dépendent en effet de contraintes géographiques, humaines (ex. : revenu des habitants) et économiques (ex. : dynamisme des bases fiscales, importance du tissu industriel ou tertiaire, etc.), qui ne garantissent pas a priori une adéquation des ressources aux charges de chaque collectivité. »
Ainsi, en 2017, le département des Yvelines a dû payer 40 millions d’euros au titre de la péréquation, montant qui sert essentiellement à financer le département de Seine-Saint-Denis. Le 93 est certes un département très endetté, mais aussi l’un des plus riches de France, car l’un de ceux qui reçoit le plus d’aides et de subventions publiques, sans compter l’ensemble des aménagements (RER, autoroutes, etc.) à quoi va s’ajouter la manne des Jeux olympiques. Pénalisant la vertu pour encourager la gabegie, la péréquation dissout les liens locaux et n’encourage pas la bonne gestion.
Le drame des logements sociaux
Difficile de faire comprendre que le logement social n’a rien de social et qu’il est un désastre pour le logement en France, notamment pour les plus pauvres. La loi SRU a aggravé la pénurie de logements, causant une hausse des prix sans précédent. C’est elle qui est en partie responsable de la difficulté des Français à se loger, bien que la majeure partie de la population croie encore que c’est avec plus d’aides et d’interventions de l’État que leur situation pourra s’améliorer. En imposant 25 % de logements sociaux dans les constructions nouvelles, c’est-à-dire 25 % de logements qui sont payés moins cher que le coût de construction, cela oblige les constructeurs à répartir le manque à gagner sur les autres logements, donc à les vendre plus cher. Des personnes qui payent donc un tarif plus élevé que le marché, pour se retrouver dans des logements identiques que des populations qui payent beaucoup moins cher. Il y a de quoi se sentir floué. D’autant que les différences de vie font que la cohabitation n’est pas toujours aisée.
Puisqu’il faut 25 % de logements sociaux partout, sans tenir compte des besoins et du marché, dans certaines villes, les logements sont vides. Dans d’autres, les propriétaires ne peuvent pas acheter des logements qui coûtent trop cher, ce qui oblige les constructeurs à renoncer à certains programmes, alors que la demande est forte. D’où un marché en tension, qui accroît la hausse des prix.
Abroger la loi SRU, supprimer les logements sociaux, notamment en vendant le parc existant, est la meilleure façon de redonner de la souplesse au marché et de produire une baisse des prix. La loi SRU répondait à un calcul cynique : en imposant 20 % de logements sociaux (quand elle fut créée), les socialistes espéraient imposer 20 % de population qui leur était favorable et donc gagner ainsi des communes lors des municipales. Un calcul de boutique politicienne dont toute la population souffre aujourd’hui.
Pour les maires récalcitrants qui ne veulent pas de 25 % de logements sociaux, des amendes étaient prévues. Mais le calcul était vite fait : il était plus rentable de payer l’amende que de construire des HLM, d’autant que la population qui vit dans les HLM est une grande consommatrice de services municipaux et de gratuité, donc elle coûte très cher. La loi Duflot a changé la donne : en plus de l’amende, qui a fortement augmenté, le préfet peut préempter des terrains et organiser des constructions forcées. C’est la fin des libertés communales et la mainmise complète de l’État. C’est dans le logement que la politique communiste est encore active, pour le malheur des populations modestes qui souffrent de cette mauvaise politique de la ville.